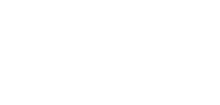Vous utilisez un navigateur non à jour ou ancien. Il ne peut pas afficher ce site ou d'autres sites correctement.
Vous devez le mettre à jour ou utiliser un navigateur alternatif.
Vous devez le mettre à jour ou utiliser un navigateur alternatif.
Postez votre CTRL/pomme -V
- Créateur du sujet cadillac
- Date de début
- Statut
- Ce sujet est fermé.
A
AntoineD
Invité
Vous devriez donner des points de réputation à d'autres avant d'en offrir de nouveau à Craquounette.
TD Droit constitutionnel
21 mars 2006 Séance n°16
Dissertation
Groupe n°1
- Plan détaillé -
«*La loi sous la Ve République*»
Attention*! Ce corrigé n’a qu’une valeur indicative*: c’est un outil de révision…
Introduction*:
«*La loi est l’expression de la volonté générale*». Enoncée dans l’article 6 de la DDHC en 1789, cette conception est issue des idées rousseauistes, théorisées ensuite par Raymond Carré de Malberg dans son ouvrage La loi, expression de la volonté générale. La tradition française a ainsi fait de la loi la norme suprême, inconditionnée, irréductible et incontrôlable à laquelle aucune autre norme ne peut porter atteinte.
En rupture avec cette longue tradition française, la Ve République introduit une innovation radicale*: elle enferme la loi dans un domaine précis, défini, limité et l’insère dans une hiérarchie des normes par le biais du contrôle de constitutionnalité. Néanmoins, cette révolution juridique est à nuancer. En effet, elle trouve ses origines dans les décrets-lois de la IIIe République, et s’agissant de la IVe République, dans la loi du 17 août 1948 ou dans l’avis du Conseil d’Etat de 1953, qui battaient déjà en brèche la compétence de droit commun de la loi.
En déterminant précisément le domaine de la loi, la Constitution de 1958 distingue ainsi la définition formelle de la définition matérielle de la loi. Les deux ne coïncident plus puisque la loi n’est pas seulement caractérisée comme l’œuvre d’un Parlement, seul dépositaire de la volonté générale. Certes, l’article 34 reprend la définition traditionnelle et dispose que la loi est votée par le Parlement. Mais ce faisant, il s’avère inexact, puisqu’il omet d’emblée les lois référendaires, les ordonnances de l’article 38 ou les actes pris en période d’application de l’article 16. Par conséquent, cette définition formelle doit être complétée par une définition matérielle*: la loi devient ainsi tout acte posant une règle générale permanente dans un domaine attribué au législatif.
Il s’agit alors de cerner dans quelle mesure cette définition matérielle de la loi est parvenue à s’imposer, en vue d’estimer si la révolution juridique annoncée a été effective au regard de la pratique depuis 1958.
A cette fin, il faut établir le constat que la loi sous la Ve République ne relève plus exclusivement du Parlement. Et quand bien même elle est l’œuvre du Législateur traditionnel, il est à démontrer que son élaboration s’effectue à la fois sous la dictée de l’exécutif et la correction du Conseil constitutionnel.
*
I – La loi ne relève plus exclusivement du Parlement
L’article 34 énonce que la loi est votée par le Parlement. En cela, il inscrit la Constitution de 1958 dans la continuité de la conception traditionnelle de la loi.
Cette disposition est cependant bien loin de correspondre à la réalité institutionnelle et pratique de la loi sous la Ve République, caractérisée par la limitation des compétences du Parlement, voire la confiscation de son rôle législatif.
Une compétence limitée du Parlement
> Art. 34 de la Constitution de 1958*: énumération des matières réservées à la loi. Dans certaines matières, la loi fixe les règles mais pour d’autres, elle ne fait qu’édicter des principes fondamentaux, le pouvoir réglementaire disposant d’une compétence subsidiaire pour édicter les règles. Cependant, cet article ne résume pas à lui seul tout le domaine de la loi, d’autres articles imposant également le recours à la loi – souvent de manière redondante. Par ailleurs, le Préambule de la Constitution renvoie aussi bien au Préambule de 1946 qu’à la Déclaration de 1789, qui font également fréquemment référence à la loi.
> Le Conseil constitutionnel lui-même est venu réduire la distinction entre les articles 34 et 37, par une décision du 30 juillet 1982, dans laquelle il affirme que la «*Constitution n’a pas entendu frapper d’inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi*». Il a ainsi consacré l’abandon de la définition matérielle de la loi, qui peut aussi porter sur des dispositions relevant normalement du domaine du règlement.
Une compétence confisquée au Parlement
Cf. art. 92 de la Constitution de 1958 (abrogé par la loi constitutionnelle du 4 août 1995)*: le gouvernement pouvait légiférer par voie d’ordonnances pour mettre en place la nouvelle Constitution (320 ordonnances émises), ces ordonnances pouvant porter sur les organes et toutes les institutions de la nation
Parallèlement, le Parlement peut être dessaisi de sa compétence au profit*:
> du peuple par l’article 11 (préciser les modalités de recours et son champ d’application)*;
> du président de la République en période d’application de l’article 16, qui prévoit la concentration de la totalité des pouvoirs entre les mains du chef de l’Etat*;
> du gouvernement, par les ordonnances de l’article 38, qui permettent au gouvernement de légiférer en lieu et place du Parlement si celui-ci est consentant, la seule exigence impliquant le Parlement étant le dépôt et le vote du projet de loi d’habilitation.
Transition*:
Si la loi ne relève plus totalement de la compétence du Parlement – ce qui était également le cas dans la pratique des Républiques antérieures avec les décrets-lois et autres lois d’habilitation de l’exécutif à légiférer, la révolution juridique annoncée de la délimitation des domaines de la loi et du règlement a finalement été un coup d’épée dans l’eau*: la loi a quasiment recouvré la plénitude de son domaine d’action.
Pour autant, certaines évolutions engagées par la Constitution de 1958 vont effectivement recevoir leur concrétisation, modifiant la conception et la pratique de la loi sous la Ve République.
II – Une œuvre parlementaire rationalisée et contrôlée
C’est sans doute dans la rationalisation et le contrôle de constitutionnalité des lois que se situe la réalité de la révolution juridique annoncée en 1958.
Paradoxalement, alors que les Constituants s’étaient focalisés sur le domaine de la loi, c’est bien l’installation – notamment par la pratique – d’un véritable contrôle de constitutionnalité qui constitue l’innovation majeure de la loi sous la Ve République
La loi sous la dictée de l’exécutif
Le gouvernement peut orienter, voire décider de la procédure législative*: il détient en effet l’initiative, la maîtrise de l’ordre du jour, la possibilité de s’opposer aux amendements, la procédure du vote bloqué, la maîtrise de la navette, la réunion de la CMP, la décision de faire statuer l’Assemblée nationale en dernier ressort, la déclaration de l’urgence, l’adoption d’un texte sans vote (49.3).
De son côté, le Président peut également demander une nouvelle délibération (art.10), consacrant une sorte de veto présidentiel provisoire en matière législative, quoique très peu usité.
Avec l’émergence du fait majoritaire, la loi devient très politisée*: elle fait l’objet d’effet d’annonce et du souci politique de voir une loi porter son nom… Cette politisation s’avère néanmoins problématique au regard de l’inflation législative*: c’est ce que le Conseil d’Etat souligne depuis une quinzaine d’années dans ses rapports annuels.
La loi sous la contrôle du Conseil constitutionnel
Rappeler l’omnipotence grandissante du Conseil dans la pratique de la loi, avec l’affirmation progressive de son pouvoir de contrôle, voire d’interprétation.
> S’agissant des ordonnances (art.38), il vérifie que la délégation n’est pas trop imprécise*: ce fut le cas notamment en 1986 sur les privatisations _ contre-pouvoir face à la majorité.
> En tant que «*chien de garde de l’exécutif*», il disqualifie une disposition législative qui serait intervenue dans le domaine réglementaire. Quand le gouvernement veut modifier un texte, il peut demander au Conseil de déclarer que ceux-ci portent bien sur des matières réglementaires (art 37.1).
De plus, le contrôle de constitutionnalité des lois a été renforcé par deux facteurs majeurs*:
1/ L’introduction de l’ensemble du Préambule dans le bloc de constitutionnalité par la décision du 16 juillet 1971 sur la liberté d’association.
2/ La révision d’octobre 1974 sur la saisine, l’étendant à soixante députés ou sénateurs, ce qui consacre le rôle de contrôle de l’opposition en matière législative.
A cela s’ajoutent les méthodes développées par le Conseil, comme l’introduction dans ses décisions de «*réserves d’interprétation*» dont la portée peut être neutralisante, ou au contraire constructive, lorsqu’elles s’apparentent à une directive.
_ D’où critique de cette puissance dévolue au Conseil, qui agite le spectre d’un «*gouvernement des juges*» (à nuancer car désormais en recul)
*
Conclusion*:
La révolution apparente de 1958 semble avoir été neutralisée en pratique, sous l’effet des circonstances politiques et du fait majoritaire. Néanmoins, la loi a subi une évolution certaine sous la Ve République.
Si le domaine de la loi tend à perdre son caractère de domaine d’attribution, la véritable innovation réside dans le fait que c’est le gouvernement et lui seul qui détermine les conditions d’intervention du législateur, et surtout dans le fait que la loi s’inscrit dans une hiérarchie des normes affermie.
La loi n’en demeure pas moins une question problématique, à l’image de l’inflation législative dénoncée de manière récurrente par le Conseil d’Etat, et en raison de l’influence croissante du droit communautaire sur la production législative nationale.
21 mars 2006 Séance n°16
Dissertation
Groupe n°1
- Plan détaillé -
«*La loi sous la Ve République*»
Attention*! Ce corrigé n’a qu’une valeur indicative*: c’est un outil de révision…
Introduction*:
«*La loi est l’expression de la volonté générale*». Enoncée dans l’article 6 de la DDHC en 1789, cette conception est issue des idées rousseauistes, théorisées ensuite par Raymond Carré de Malberg dans son ouvrage La loi, expression de la volonté générale. La tradition française a ainsi fait de la loi la norme suprême, inconditionnée, irréductible et incontrôlable à laquelle aucune autre norme ne peut porter atteinte.
En rupture avec cette longue tradition française, la Ve République introduit une innovation radicale*: elle enferme la loi dans un domaine précis, défini, limité et l’insère dans une hiérarchie des normes par le biais du contrôle de constitutionnalité. Néanmoins, cette révolution juridique est à nuancer. En effet, elle trouve ses origines dans les décrets-lois de la IIIe République, et s’agissant de la IVe République, dans la loi du 17 août 1948 ou dans l’avis du Conseil d’Etat de 1953, qui battaient déjà en brèche la compétence de droit commun de la loi.
En déterminant précisément le domaine de la loi, la Constitution de 1958 distingue ainsi la définition formelle de la définition matérielle de la loi. Les deux ne coïncident plus puisque la loi n’est pas seulement caractérisée comme l’œuvre d’un Parlement, seul dépositaire de la volonté générale. Certes, l’article 34 reprend la définition traditionnelle et dispose que la loi est votée par le Parlement. Mais ce faisant, il s’avère inexact, puisqu’il omet d’emblée les lois référendaires, les ordonnances de l’article 38 ou les actes pris en période d’application de l’article 16. Par conséquent, cette définition formelle doit être complétée par une définition matérielle*: la loi devient ainsi tout acte posant une règle générale permanente dans un domaine attribué au législatif.
Il s’agit alors de cerner dans quelle mesure cette définition matérielle de la loi est parvenue à s’imposer, en vue d’estimer si la révolution juridique annoncée a été effective au regard de la pratique depuis 1958.
A cette fin, il faut établir le constat que la loi sous la Ve République ne relève plus exclusivement du Parlement. Et quand bien même elle est l’œuvre du Législateur traditionnel, il est à démontrer que son élaboration s’effectue à la fois sous la dictée de l’exécutif et la correction du Conseil constitutionnel.
*
I – La loi ne relève plus exclusivement du Parlement
L’article 34 énonce que la loi est votée par le Parlement. En cela, il inscrit la Constitution de 1958 dans la continuité de la conception traditionnelle de la loi.
Cette disposition est cependant bien loin de correspondre à la réalité institutionnelle et pratique de la loi sous la Ve République, caractérisée par la limitation des compétences du Parlement, voire la confiscation de son rôle législatif.
Une compétence limitée du Parlement
> Art. 34 de la Constitution de 1958*: énumération des matières réservées à la loi. Dans certaines matières, la loi fixe les règles mais pour d’autres, elle ne fait qu’édicter des principes fondamentaux, le pouvoir réglementaire disposant d’une compétence subsidiaire pour édicter les règles. Cependant, cet article ne résume pas à lui seul tout le domaine de la loi, d’autres articles imposant également le recours à la loi – souvent de manière redondante. Par ailleurs, le Préambule de la Constitution renvoie aussi bien au Préambule de 1946 qu’à la Déclaration de 1789, qui font également fréquemment référence à la loi.
> Le Conseil constitutionnel lui-même est venu réduire la distinction entre les articles 34 et 37, par une décision du 30 juillet 1982, dans laquelle il affirme que la «*Constitution n’a pas entendu frapper d’inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi*». Il a ainsi consacré l’abandon de la définition matérielle de la loi, qui peut aussi porter sur des dispositions relevant normalement du domaine du règlement.
Une compétence confisquée au Parlement
Cf. art. 92 de la Constitution de 1958 (abrogé par la loi constitutionnelle du 4 août 1995)*: le gouvernement pouvait légiférer par voie d’ordonnances pour mettre en place la nouvelle Constitution (320 ordonnances émises), ces ordonnances pouvant porter sur les organes et toutes les institutions de la nation
Parallèlement, le Parlement peut être dessaisi de sa compétence au profit*:
> du peuple par l’article 11 (préciser les modalités de recours et son champ d’application)*;
> du président de la République en période d’application de l’article 16, qui prévoit la concentration de la totalité des pouvoirs entre les mains du chef de l’Etat*;
> du gouvernement, par les ordonnances de l’article 38, qui permettent au gouvernement de légiférer en lieu et place du Parlement si celui-ci est consentant, la seule exigence impliquant le Parlement étant le dépôt et le vote du projet de loi d’habilitation.
Transition*:
Si la loi ne relève plus totalement de la compétence du Parlement – ce qui était également le cas dans la pratique des Républiques antérieures avec les décrets-lois et autres lois d’habilitation de l’exécutif à légiférer, la révolution juridique annoncée de la délimitation des domaines de la loi et du règlement a finalement été un coup d’épée dans l’eau*: la loi a quasiment recouvré la plénitude de son domaine d’action.
Pour autant, certaines évolutions engagées par la Constitution de 1958 vont effectivement recevoir leur concrétisation, modifiant la conception et la pratique de la loi sous la Ve République.
II – Une œuvre parlementaire rationalisée et contrôlée
C’est sans doute dans la rationalisation et le contrôle de constitutionnalité des lois que se situe la réalité de la révolution juridique annoncée en 1958.
Paradoxalement, alors que les Constituants s’étaient focalisés sur le domaine de la loi, c’est bien l’installation – notamment par la pratique – d’un véritable contrôle de constitutionnalité qui constitue l’innovation majeure de la loi sous la Ve République
La loi sous la dictée de l’exécutif
Le gouvernement peut orienter, voire décider de la procédure législative*: il détient en effet l’initiative, la maîtrise de l’ordre du jour, la possibilité de s’opposer aux amendements, la procédure du vote bloqué, la maîtrise de la navette, la réunion de la CMP, la décision de faire statuer l’Assemblée nationale en dernier ressort, la déclaration de l’urgence, l’adoption d’un texte sans vote (49.3).
De son côté, le Président peut également demander une nouvelle délibération (art.10), consacrant une sorte de veto présidentiel provisoire en matière législative, quoique très peu usité.
Avec l’émergence du fait majoritaire, la loi devient très politisée*: elle fait l’objet d’effet d’annonce et du souci politique de voir une loi porter son nom… Cette politisation s’avère néanmoins problématique au regard de l’inflation législative*: c’est ce que le Conseil d’Etat souligne depuis une quinzaine d’années dans ses rapports annuels.
La loi sous la contrôle du Conseil constitutionnel
Rappeler l’omnipotence grandissante du Conseil dans la pratique de la loi, avec l’affirmation progressive de son pouvoir de contrôle, voire d’interprétation.
> S’agissant des ordonnances (art.38), il vérifie que la délégation n’est pas trop imprécise*: ce fut le cas notamment en 1986 sur les privatisations _ contre-pouvoir face à la majorité.
> En tant que «*chien de garde de l’exécutif*», il disqualifie une disposition législative qui serait intervenue dans le domaine réglementaire. Quand le gouvernement veut modifier un texte, il peut demander au Conseil de déclarer que ceux-ci portent bien sur des matières réglementaires (art 37.1).
De plus, le contrôle de constitutionnalité des lois a été renforcé par deux facteurs majeurs*:
1/ L’introduction de l’ensemble du Préambule dans le bloc de constitutionnalité par la décision du 16 juillet 1971 sur la liberté d’association.
2/ La révision d’octobre 1974 sur la saisine, l’étendant à soixante députés ou sénateurs, ce qui consacre le rôle de contrôle de l’opposition en matière législative.
A cela s’ajoutent les méthodes développées par le Conseil, comme l’introduction dans ses décisions de «*réserves d’interprétation*» dont la portée peut être neutralisante, ou au contraire constructive, lorsqu’elles s’apparentent à une directive.
_ D’où critique de cette puissance dévolue au Conseil, qui agite le spectre d’un «*gouvernement des juges*» (à nuancer car désormais en recul)
*
Conclusion*:
La révolution apparente de 1958 semble avoir été neutralisée en pratique, sous l’effet des circonstances politiques et du fait majoritaire. Néanmoins, la loi a subi une évolution certaine sous la Ve République.
Si le domaine de la loi tend à perdre son caractère de domaine d’attribution, la véritable innovation réside dans le fait que c’est le gouvernement et lui seul qui détermine les conditions d’intervention du législateur, et surtout dans le fait que la loi s’inscrit dans une hiérarchie des normes affermie.
La loi n’en demeure pas moins une question problématique, à l’image de l’inflation législative dénoncée de manière récurrente par le Conseil d’Etat, et en raison de l’influence croissante du droit communautaire sur la production législative nationale.
"FAIRE LE VIN DU CONSOMMATEUR ET NON CELUI DU PRODUCTEUR" "S'ADAPTER À LA MONDIALISATION"
Voilà, c'est fait, MONDOVINO est en route, le vin français perd des PDM à l'étranger, alors on le mondialise, le raisonnement par l'absurde, face à la concurrence, seul la spécialisation permet de ne pas mourir, bah là nan on va globaliser, standardiser, moi ça me dégoûte franchement, ça me donne envie de dégueuler cette bêtise.
Faire le vin du consommateur, voilà qui résume tout, c'est clairement dit par nos dirigeants, on doit faire le vin que le consommateur veut, le consommateur que je suis, forcément ignare, forcément vulgaire, ce n'est pas moi qui doit décider du goût du vin il faut qu'on me l'impose sinon je l'anéantirai par mon incompétence !
C'est valable pour tout, moi en tant que consommateur je préfère choisir ce que l'on m'imposera, je ne veux en aucun cas qu'on me demande mon avis pour essayer d'y coller, ça me semble être pourtant du bon sens mais non c'est l'autre voie qu'on choisit, le marketing destructeur, destructeur du produit, puis de l'histoire, de l'homme....
De plus c'est une pure illusion, le consommateur ne décide de rien, le marketing le fait pour lui 95 % du temps, il lui impose de manière intéressé des changements et le consommateur s'habitue malgré lui.
Ah oui j'oubliais, s'adapter à la mondialisation ça veut dire entre autres, mettre des copeaux de bois dans le vin pour lui donner plus de goût, GENIAL.
Mais en tant que consoacteur, là on me demande pas mon avis bien sûr, si je dis que je voudrais que ça soit marqué sur les bouteilles, on va me dire que c'est pas possible, comme ça pour boycotter faudra une fois de plus que je sois hypra informé, de la merde oui.
MANGER DES COPEAUX DE BOIS TUE !
Voilà, c'est fait, MONDOVINO est en route, le vin français perd des PDM à l'étranger, alors on le mondialise, le raisonnement par l'absurde, face à la concurrence, seul la spécialisation permet de ne pas mourir, bah là nan on va globaliser, standardiser, moi ça me dégoûte franchement, ça me donne envie de dégueuler cette bêtise.
Faire le vin du consommateur, voilà qui résume tout, c'est clairement dit par nos dirigeants, on doit faire le vin que le consommateur veut, le consommateur que je suis, forcément ignare, forcément vulgaire, ce n'est pas moi qui doit décider du goût du vin il faut qu'on me l'impose sinon je l'anéantirai par mon incompétence !
C'est valable pour tout, moi en tant que consommateur je préfère choisir ce que l'on m'imposera, je ne veux en aucun cas qu'on me demande mon avis pour essayer d'y coller, ça me semble être pourtant du bon sens mais non c'est l'autre voie qu'on choisit, le marketing destructeur, destructeur du produit, puis de l'histoire, de l'homme....
De plus c'est une pure illusion, le consommateur ne décide de rien, le marketing le fait pour lui 95 % du temps, il lui impose de manière intéressé des changements et le consommateur s'habitue malgré lui.
Ah oui j'oubliais, s'adapter à la mondialisation ça veut dire entre autres, mettre des copeaux de bois dans le vin pour lui donner plus de goût, GENIAL.
Mais en tant que consoacteur, là on me demande pas mon avis bien sûr, si je dis que je voudrais que ça soit marqué sur les bouteilles, on va me dire que c'est pas possible, comme ça pour boycotter faudra une fois de plus que je sois hypra informé, de la merde oui.
MANGER DES COPEAUX DE BOIS TUE !
A
AntoineD
Invité
Le Ponk !
Donc ici tu as deux mp3 made in france par le groupe (encore vivant) GuÈrilla Poubelle, et deux morceaux plus punk-core qu'on doit aux SuÈdois de Raised Fist. Dans le style plus punk pur, y'a d'abord les ancÍtres (The Clash, The Sex Pistols), et aussi les lÈgendes de la scËne punk franÁaise : les BÈruriers Noirs o? encore Ludwig Von 88.
Album : BÈruriers Noirs "Souvent FauchÈ Toujours Marteau"
Donc ici tu as deux mp3 made in france par le groupe (encore vivant) GuÈrilla Poubelle, et deux morceaux plus punk-core qu'on doit aux SuÈdois de Raised Fist. Dans le style plus punk pur, y'a d'abord les ancÍtres (The Clash, The Sex Pistols), et aussi les lÈgendes de la scËne punk franÁaise : les BÈruriers Noirs o? encore Ludwig Von 88.
Album : BÈruriers Noirs "Souvent FauchÈ Toujours Marteau"
J'étais SMG , j'ai changé mais toi tu restes a cette opinion que tu as eu de moi ..
A
Anonyme
Invité
plaçait plaçait plaçait plaçait plaçait plaçait plaçait plaçait plaçait
çà et là çà et là çà et là çà et là çà et là çà et là çà et là çà et là
tronçon tronçon tronçon tronçon tronçon tronçon tronçon tronçon tronçon
garçon garçon garçon garçon garçon garçon garçon garçon garçon garçon
reçoivent reçoivent reçoivent reçoivent reçoivent reçoivent reçoivent
façonné façonné façonné façonné façonné façonné façonné façonné façonné
français j'aperçus français j'aperçus français j'aperçus français j'aperçus
j'aperçus français j'aperçus français j'aperçus français j'aperçus français
rançon menaçait rançon menaçait rançon menaçait rançon menaçait rançon
menaçait rançon menaçait rançon menaçait rançon menaçait rançon menaçait
dit-on dit-on ci-joints ci-joints dit-on dit-on ci-joints ci-joints
ci-joints ci-joints dit-on dit-on ci-joints ci-joints dit-on dit-on
(c'est vrai) (c'est vrai) (c'est vrai) (c'est vrai) (c'est vrai)
(c'est faux) (c'est faux) (c'est faux) (c'est faux) (c'est faux)
soigneusement caleçon soigneusement caleçon soigneusement caleçon
caleçon soigneusement caleçon soigneusement caleçon soigneusement
maçon commerçant maçon commerçant maçon commerçant maçon commerçant
commerçant maçon commerçant maçon commerçant maçon commerçant maçon
-d'après un dit-on- -d'après un dit-on- -d'après un dit-on-
-d'après un dit-on- -d'après un dit-on- -d'après un dit-on-
bric-à-brac bric-à-brac bric-à-brac bric-à-brac bric-à-brac bric-à-brac
bric-à-brac bric-à-brac bric-à-brac bric-à-brac bric-à-brac bric-à-brac
box-calf box-calf box-calf box-calf box-calf box-calf box-calf box-calf
box-calf box-calf box-calf box-calf box-calf box-calf box-calf box-calf
Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
Notre brave négociant navigue çà et là sans façon.
Notre brave négociant navigue çà et là sans façon.
Notre brave négociant navigue çà et là sans façon.
Ce général garda soigneusement (c'est vrai) le tronçon de l'épée.
Ce général garda soigneusement (c'est vrai) le tronçon de l'épée.
Ce général garda soigneusement (c'est vrai) le tronçon de l'épée.
Les garçons -d'après un dit-on- ne font pas attention aux punitions qu'ils
reçoivent. Les garçons -d'après un dit-on- ne font pas attention aux
punitions qu'ils reçoivent. Les garçons -d'après un dit-on- ne font pas
attention aux punitions qu'ils reçoivent.
L'artiste français a façonné le bloc de marbre. L'artiste français a
façonné le bloc de marbre. L'artiste français a façonné le bloc de marbre.
L'artiste français a façonné le bloc de marbre.
Vous avez reçu les documents ci-joints. Vous avez reçu les documents
ci-joints. Vous avez reçu les documents ci-joints. Vous avez reçu les
documents ci-joints. Vous avez reçu les documents ci-joints.
Le caleçon de ce maçon est à court de boutons. Le caleçon de ce maçon est à
court de boutons. Le caleçon de ce maçon est à court de boutons. Le caleçon
de ce maçon est à court de boutons. Le caleçon de ce maçon est à court de
boutons. Le commerçant du canton agit sans façon. Le commerçant du canton
agit sans façon. Le commerçant du canton agit sans façon. Le commerçant du
canton agit sans façon. Le commerçant du canton agit sans façon.
J'ai trouvé dans ce bric-à-brac un brûle-parfum et des chaussures en
box-calf. J'ai trouvé dans ce bric-à-brac un brûle-parfum et des chaussures
en box-calf. J'ai trouvé dans ce bric-à-brac un brûle-parfum et des
chaussures en box-calf.
Voyez le brick géant que j'examine près du wharf. Voyez le brick géant que
j'examine près du wharf. Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. Portez ce vieux whisky au juge
blond qui fume. Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume.
Voyez ce bon fakir moqueur pousser un wagon en jouant du xylophone.
Voyez ce bon fakir moqueur pousser un wagon en jouant du xylophone.
çà et là çà et là çà et là çà et là çà et là çà et là çà et là çà et là
tronçon tronçon tronçon tronçon tronçon tronçon tronçon tronçon tronçon
garçon garçon garçon garçon garçon garçon garçon garçon garçon garçon
reçoivent reçoivent reçoivent reçoivent reçoivent reçoivent reçoivent
façonné façonné façonné façonné façonné façonné façonné façonné façonné
français j'aperçus français j'aperçus français j'aperçus français j'aperçus
j'aperçus français j'aperçus français j'aperçus français j'aperçus français
rançon menaçait rançon menaçait rançon menaçait rançon menaçait rançon
menaçait rançon menaçait rançon menaçait rançon menaçait rançon menaçait
dit-on dit-on ci-joints ci-joints dit-on dit-on ci-joints ci-joints
ci-joints ci-joints dit-on dit-on ci-joints ci-joints dit-on dit-on
(c'est vrai) (c'est vrai) (c'est vrai) (c'est vrai) (c'est vrai)
(c'est faux) (c'est faux) (c'est faux) (c'est faux) (c'est faux)
soigneusement caleçon soigneusement caleçon soigneusement caleçon
caleçon soigneusement caleçon soigneusement caleçon soigneusement
maçon commerçant maçon commerçant maçon commerçant maçon commerçant
commerçant maçon commerçant maçon commerçant maçon commerçant maçon
-d'après un dit-on- -d'après un dit-on- -d'après un dit-on-
-d'après un dit-on- -d'après un dit-on- -d'après un dit-on-
bric-à-brac bric-à-brac bric-à-brac bric-à-brac bric-à-brac bric-à-brac
bric-à-brac bric-à-brac bric-à-brac bric-à-brac bric-à-brac bric-à-brac
box-calf box-calf box-calf box-calf box-calf box-calf box-calf box-calf
box-calf box-calf box-calf box-calf box-calf box-calf box-calf box-calf
Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
Notre brave négociant navigue çà et là sans façon.
Notre brave négociant navigue çà et là sans façon.
Notre brave négociant navigue çà et là sans façon.
Ce général garda soigneusement (c'est vrai) le tronçon de l'épée.
Ce général garda soigneusement (c'est vrai) le tronçon de l'épée.
Ce général garda soigneusement (c'est vrai) le tronçon de l'épée.
Les garçons -d'après un dit-on- ne font pas attention aux punitions qu'ils
reçoivent. Les garçons -d'après un dit-on- ne font pas attention aux
punitions qu'ils reçoivent. Les garçons -d'après un dit-on- ne font pas
attention aux punitions qu'ils reçoivent.
L'artiste français a façonné le bloc de marbre. L'artiste français a
façonné le bloc de marbre. L'artiste français a façonné le bloc de marbre.
L'artiste français a façonné le bloc de marbre.
Vous avez reçu les documents ci-joints. Vous avez reçu les documents
ci-joints. Vous avez reçu les documents ci-joints. Vous avez reçu les
documents ci-joints. Vous avez reçu les documents ci-joints.
Le caleçon de ce maçon est à court de boutons. Le caleçon de ce maçon est à
court de boutons. Le caleçon de ce maçon est à court de boutons. Le caleçon
de ce maçon est à court de boutons. Le caleçon de ce maçon est à court de
boutons. Le commerçant du canton agit sans façon. Le commerçant du canton
agit sans façon. Le commerçant du canton agit sans façon. Le commerçant du
canton agit sans façon. Le commerçant du canton agit sans façon.
J'ai trouvé dans ce bric-à-brac un brûle-parfum et des chaussures en
box-calf. J'ai trouvé dans ce bric-à-brac un brûle-parfum et des chaussures
en box-calf. J'ai trouvé dans ce bric-à-brac un brûle-parfum et des
chaussures en box-calf.
Voyez le brick géant que j'examine près du wharf. Voyez le brick géant que
j'examine près du wharf. Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. Portez ce vieux whisky au juge
blond qui fume. Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume.
Voyez ce bon fakir moqueur pousser un wagon en jouant du xylophone.
Voyez ce bon fakir moqueur pousser un wagon en jouant du xylophone.
kanako a dit:06 72 97 38 **
^^
Les copier/coller retouchés c'est pas d'jeu ! :mouais:
Je passe à table
- Statut
- Ce sujet est fermé.
Sujets similaires
macOS Sequoia
mac os Sequoia 15.3 et le menu pomme
- Réponses
- 5
- Affichages
- 682
10.15 Catalina
Plantage de recherche/20241113531
- Réponses
- 4
- Affichages
- 494