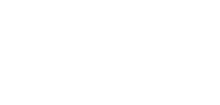Oui, mais depuis, ils l'ont fermé cette école là - pas réaliste, pas rentable.
La liberté est un état immobile, une phase hors du temps face au champs des possibles.
Ensuite, tu fais des choix.
La liberté, c'est le menu, ta vie, c'est ce que tu manges - est vraiment libre celui qui se retrouve face à un menbu pléthorique et dont le choix est le moins dicté par le hasard, l'environnement ou ses instincts.
( En gros, si je fume pour faire comme les potes, je ne suis pas libre - ou assez peu.
Si je fume parce que j'ai estimé que le plaisir que j'en retirais équilibrais le coût financier et les risques sanitaires, alors je le suis déjà plus. )
Bref, la liberté est un état absolu.
Il n'y a rien à accorder. Pas d'antagonismes.
Ce qui n'est bien sûr pas le cas des choix qui découlent de son exercice - et ces choix, eux, peuvent parfaitement être opposés, voire antagonistes d'une personne à l'autre.
D'où la loi.
Qui parfois est obligée de trancher dans le vif.
C'est ça.
La loi n'oppose ni n'accorde, elle tranche.
La loi, pour reprendre ma métaphore gastronomique est une restriction du menu de chacun dans le but d'offrir un menu minimum à tous.
Et les lois anti-tabac?
Comme non fumeur, je les trouve bien.
Comme "connaissant des fumeurs" je ne les trouve pas particulièrement contre.
Et je n'ai pas vraiment constaté ce que tu crains de despotisme moral aux petits pieds chez le non-fumeur dans la rue - hors pourcentage malheureusement usuel et également répandu dans totues les catégories de la population, de trous du cul indécrotables.
La liberté, état absolu ? Oui, bien sûr. La liberté, cest la vie ? Effectivement. Être et être libre, cest une seule et même chose, disait un fumeur de pipe qui pensait.
Mais, précisément, je parlais de lexercice de la liberté, non de son « essence ». Ceci parce que le droit ne concerne que cet exercice. Et quand je disais « accord », je ne lentendais pas au sens musical, mais au sens mécanique. Non pas créer une symphonie des libertés, un monde dharmonie des choix, mais éviter les collisions, le choc frontal des volontés en mouvement. Cest bien là ce que doit faire la loi. Alors, oui, elle tranche. Ou, plutôt, elle découpe. Des sphères deffectivité pour les libertés, des espaces où elles peuvent saffirmer sans se heurter. Et pour rester dans la métaphore mécanique et spatiale, elle doit découper équitablement, sinon on voit mal ce qui pourrait fonder sa légitimité. Or, ce nest pas ce que font les lois antitabac. Elles ont restreint drastiquement la sphère de liberté des fumeurs : interdiction de fumer dans les établissements publics, même en plein air, même sil ny a personne à moins de cent mètres ; restaurants, bars, etc. désormais non-fumeurs. Le choix qui est laissé au fumeur, cest darrêter de fumer ou de rester chez lui. Lespace qui lui est concédé, cest celui du trottoir.
De plus, ces lois, au fond, nen sont pas. Un philosophe chauve faisait remarquer que, depuis bientôt deux siècles, on assistait à un glissement de la loi vers la norme. Les lois anti-tabac sont exemplaires de ce glissement. LEtat, devenu bio-pouvoir, nest plus tellement caractérisé par un droit de punir, mais bien plutôt par une action sur le corps afin, dit le chauve, de procéder « à son dressage, à la majoration de ses aptitudes, à lextorsion de ses forces, à la croissance parallèle de son utilité et de sa docilité, à son intégration à des systèmes de contrôle efficaces et économiques ». Les lois anti-tabac relèvent dune bio-politique qui vise, en disciplinant les corps, à normaliser, à rentabiliser les comportements