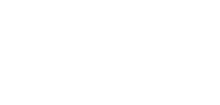Si on ajoute à ça le fait que dans certaines zones, plus ou moins "ghettoisées", une forte proportion des garçons de plus de six ans ne va à l'école que lorsqu'elle en a envie, les parents ayant abdiqués toute autorité sur eux, et ce conjointement avec une proportion moindre, mais importante aussi des filles, là, soit pour les mêmes raisons que les garçons, soit parce que les parents les en empêchent carrément, je pense que si les parents ne sont pas responsables de tout, il n'en restent pas moins responsables d'une fraction importante de l'évolution du phénomène, et ce, statistique ou pas !
Bonjour
Va me falloir discuter sérieusement, à l'encontre de mon habitude. Pour préciser, j'ai participé à pas mal de travaux sur la question, tant concernant l'illettrisme que "l'échec scolaire", que la ghéttoïsation de certaines zones (et à ce titre ai défendu les ZEP, mais aussi une autre politique de la ville et de l'urbanisme), la déscolarisation (y compris chez les communautés nomades).
* Les élèves arrivant analphabètes en 6 ème sont rarissimes, beaucoup plus rares qu'autrefois. Une maîtrise incomplète de la langue n'est ni alphabétisme, ni illettrisme. La formation "tout au long de la vie" peut largement y remédier.
Les tests actuellement infligés aux élèves sont un summum de manque de rigueur scientifique. Ils affolent ou rassurent des parents sur des bases bien peu sérieuses, et ne servent qu'à faire croire que les autorités en place font quelque chose. parfois aussi, à classer les écoles et établissements
* Il est probable par contre que le nombre d'élèves arrivant (et restant) démotivés est en augmentation, non tant par l'école que par le fait qu'elle n'est plus ressentie comme ascenseur social (même si ce ressenti ne correspond pas à la réalité). Mais il s'agit d'un problème à résoudre par la société en son ensemble, pas par l'école en particulier (chômage, par exemple). attitude relativement récente (milieu ou fin des années 80)
* Il y a une très nette corrélation entre la carte des maladies "sociales" (ex : alcoolisme) et celles de l'échec scolaire (sortie niveau VI) (et ce, jusqu'au niveau du canton)
* Aussi paradoxal que cela puisse paraître, Corse mise à part, en France métropolitaine, les régions dont les populations sont les moins diplômées sont celles qui ont connu le plein emploi : la certitude d'avoir un travail (situation depuis le XIX siècle) conduit à ne pas fréquenter l'école, voire à la rejeter. Cela devient un fait culturel, difficile à surmonter. Les statistiques de réussite au bac montrent un différentiel toujours important entre ces régions et celles qui, pour des raisons inverses, ont une culture des études. Le niveau culturel d'une génération tend à se reproduire dans la génération suivante. D'autant plus que dans ces régions, la scolarisation en préscolaire (la plus grande réussite de l'école française, souvent étudiée pour adaptation par les pays étrangers, ce que l'on oublie souvent de citer), facteur le plus déterminant pour pallier les lacunes culturelles parentales est la moins développée (pas de nécessité historiques, besoin de main d'uvre à bon marché, donc peu qualifié, et habitudes culturelles ne conduisant pas forcément les autorités locales a fournir les efforts financiers. (J'ai ainsi le souvenir des propos d'un sénateur, président de l'Union des Maires de son département, défendre dans une réunion officielle sous l'égide du Préfet qu'ilétait tout à fait légitime pour un maire de choisir une salle des fêtes plutôt qu'une école maternelle, légitimité de par son élection). Le différentiel tend cependant à s'amoindrir.
* Sur la comparaison entre aujourd'hui et hier, je renvoie aux travaux de Charlot (en particulier sur la docimologie), d'Estager (sur le niveau des élèves) et Ph. Meirieu (rapport entre origine sociale et résultats scolaires). Les uns et les autres démolissent l'idée préconçue de la baisse du niveau des élèves. Compte tenu de l'amas de connaissances demandés dans des domaines nouveaux, c'est plutôt le contraire qui se produit.
* Pour les élèves en difficultés, l'enseignement privé (il n'est pas que confessionnel) a un effet très pervers. On a l'habitude d'expliquer que l'apprentissage permet à des élèves d'émerger. On oublie d'indiquer que cette formation, par une sélection très stricte (avant ou pendant), ne s'adresse qu'à des élèves très motivés, et dispose de moyens considérables (j'ai eu l'occasion d'auditionner pas mal de CFA, et j'en suis resté ébahi). Or, cet écrémage d'élèves et de fonds s'effectuent au détriment des collèges et LP (Viennent dans ces établissements les élèves en difficultés et démotivés, leur donnant leur mauvaise réputation, et ce dans des conditions matérielles ne permettant guère de motiver les élèves . . .). Il en va de même dans une ville connaissent de graves problèmes sociaux : le départ systématique vers l'enseignement privé (qui sélectionne à outrance, n'ayant pas les mêmes contraintes) prive le lycée public d'une partie des élèves qui auraient pu servir de modèle aux autres. Sans compter que la disparition programmée de la mixité sociale et culturelle peut, à très court terme avoir des effets pervers (ex : embrasement de banlieue par des jeunes se ressentant rejetés).
* sur l'attitude des parents vis à vis des enseignants, je conseille à ces derniers (ou plus exactement, je conseillais - l'âge) d'inviter régulièrement un petit groupe de parents à venir suivre un cours, puis en discuter ensuite (ce n'est pas du tout dans la culture des enseignants). Résultats garantis : les parents voient alors d'un autre il leurs enfants, et découvrent que le travail en classe est bien éloigné de ce qu'ils croyaient.
* Elèves en grandes difficulté (SES, SEGPA, IRA). Il y a eu, au cours des ans un glissement très pervers, et imperceptible d'élèves relevant de structures médicalisées (type IMP) vers les structures de collèges (relevant ainsi d'autant les statistiques de sortie niveau VI, - les IMP n'étant pas pris en compte), tandis que que les élèves relevant des SES . . . étaient dirigés vers les classes "indifférenciées" des collèges, avec une double conséquence, et sur les élèves ne disposant plus d'une structure adaptée, et sur les autres élèves, subissant le contre coup de la présence de ces élèves.
Pour conclure, provisoirement, je réitère : l'illettrisme est pour l'essentiel un mécanisme intellectuel concernant des adultes, rarement les ado quittant le système de formation initiale.
JM